Définitions importantes
La nature : on peut définir la nature comme l’ensemble des espaces, des êtres qui n’ont pas été créés ou transformés par l’homme. (ex : une forêt vierge). Elle s’oppose donc à ce qui artificiel ou culturel.
La culture au sens d’agriculture : la culture, c’est la transformation de la nature (ce qui est donné) dans le but de servir l’homme.
La culture au sens d’être cultivé : la culture, c’est également la transformation de notre nature humaine. Il s’agit alors d’élever notre esprit. Cela passe par l’instruction (acquisition de connaissances et développement de la raison) et l’éducation (apprendre à bien se comporter avec les autres).
La culture au sens de civilisation : en ce sens, on parle des cultures. Une culture, c’est l’ensemble constitué des règles, coutumes, croyances, idées, groupe social.
Autres définitions
Universel : qui vaut pour tous les individus d’une classe d’objets sans aucune exception.
Particulier : qui vaut pour quelques cas ou un groupe.
Singulier : qui vaut pour un seul cas.
Problèmes et thèses essentielles

Philosophe français du 17ᵉ siècle.
Le projet de maitriser la nature est-il raisonnable ?
Oui, l'homme peut le faire grâce à la science
Thèse : La science permettra à l’homme d’être maître de la nature
Selon Descartes, les sciences n’ont pas seulement un intérêt théorique, mais aussi un intérêt pratique c’est-à-dire qu’elles peuvent nous être utiles et améliorer la vie des hommes. En effet, si nous connaissons les lois de la nature, il va alors être possible pour nous de nous protéger et survivre plus facilement. Descartes pense notamment aux progrès de médecine et aux progrès que l’homme pourrait faire en agriculture par exemple.
Citation :
« Grâce à la science, nous pourrions nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. »
Descartes, Discours de la méthode

philosophe français du 17ᵉ siècle.
Le projet de maitriser la nature est-il raisonnable ?
Non, car l'homme est faible par rapport à la nature
Thèse : L’homme est un être misérable dans l’univers.
Dans la pensée ci-dessous, Pascal met en avant le caractère contradictoire de l’homme. Selon lui, les hommes sont des êtres étranges car, à la fois, ils prétendent juger de tout et leur esprit puissant leur permet d’espérer comprendre l’univers, mais, dans le même temps, ce sont des êtres misérables. Ils sont misérables car, d’une part, ils sont très petits et très faibles physiquement, mais également car, d’autre part, ils ne sont pas omniscients et peuvent se tromper lourdement dans leurs jugements. C’est pourquoi, les êtres humains ne sont pas capables de comprendre l’infiniment grand et l’infiniment petit selon lui. Maîtriser la nature ne semble alors pas raisonnable.
Citation :
« Quelle chimère est-ce donc que l’homme, quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige, juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d’incertitude et d’erreur, gloire et rebut de l’univers ! »
Pascal, Pensées, 434

Philosophe allemand du 18ᵉ siècle.
Avons-nous des devoirs envers la nature ?
Non, nous n'avons de devoirs qu'envers les hommes
Thèse : Nous avons des devoirs envers les êtres doués de raison.
Au premier abord, l’idée que nous ayons des devoirs envers la nature n’est pas évidente. Kant explique notamment que les autres êtres vivants n’ont pas de conscience morale et pas de raison. Or, nous n’avons, selon lui, de devoir qu’envers les êtres qui ont une raison et qui sont donc capables d’avoir leurs propres buts dans la vie. De plus, si les êtres vivants n’ont pas de conscience du bien et du mal, cela signifie qu’ils sont incapables de nous respecter, nous, êtres humains. Il n’y aurait donc pas de sens à respecter des êtres qui ne nous respectent pas. La morale de Kant ne donne donc réellement de valeur qu’aux hommes doués de raison.
Citation :
« A en juger d’après la seule raison l’homme n’a pas d’autres devoirs que les devoirs envers l’homme. »
Kant, Métaphysique des moeurs

philosophe français du 16ᵉ siècle.
Avons-nous des devoirs envers la nature ?
Oui, car les êtres vivants sont sensibles
Thèse : Les êtres naturels doivent être respectés car ils sont sensibles.
Pour Montaigne nous avons des devoirs envers la nature et les êtres sensibles d’une manière générale car ces êtres que ce soit des animaux, des arbres ou des plantes ont une capacité de ressentir. Nous devons donc prendre en compte cette sensibilité et nous montrer bienveillant à leur égard et ne pas les torturer ou leur faire du mal gratuitement. Pour Montaigne, la barrière que nous mettons entre les hommes et les animaux n’est pas fondée. Il n’y a pas tant de différence entre nous.
Citation :
« Je me démets volontiers de cette royauté imaginaire qu’on nous donne sur les autres créatures. … Il y a un certain égard et un devoir général d’humanité qui nous attache non seulement aux bêtes qui ont vie et sensibilité, mais aux arbres eux-mêmes et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes, et la douceur et la bienveillance aux autres créatures, qui peuvent être capables de les ressentir. Il y a quelques relations sociales entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle. »
Montaigne, Essais, II, 11 De la cruauté
–

Philosophe allemand du 18ᵉ siècle.
La culture dénature-t-elle l'homme ?
Non, l'homme a besoin de la culture pour devenir homme
Thèse : C’est par l’éducation que l’homme devient un homme.
Loin de le dénaturer, la culture est nécessaire à l’homme pour le rendre réellement humain. Sans l’éducation l’homme ne se développe pas, il ne réalise pas sa nature d’homme. Selon Kant, dans le Traité de Pédagogie, l’homme a besoin d’une part, de discipline et d’autre part, d’instruction. Cela signifie qu’il doit d’abord apprendre à suivre des règles, c’est cette discipline qui permet au petit humain de sortir de l’animalité en lui fixant des limites et en l’empêchant de tomber dans ses mauvais penchants (violence, paresse, excès). Cette discipline est essentielle car ayant appris à suivre des règles, le petit homme sera ensuite capable de son donner ses propres règles et de les suivre (autonomie).
Citation :
« L’homme ne peut devenir homme que par l’éducation n’est que ce que l’éducation fait de lui. »
Kant, Traité de Pédagogie
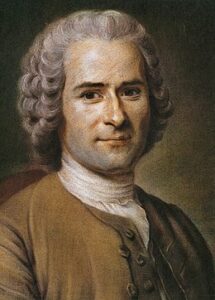
Portrait
La culture dénature-t-elle l'homme ?
Oui, la culture fait perdre à l'homme des qualités naturelles
Thèse : L’homme civilisé devient faible et méchant.
Rousseau est plutôt critique à l’égard de la culture. Dans le Discours sur l’inégalité, il compare les hommes civilisés à l’homme sauvage et remarque combien les hommes civilisés sont devenues plus faibles. Le développement de techniques et d’outils, les aident, mais il les rend aussi dépendants. Les hommes ne peuvent plus s’en passer car ils ont alors perdu la force naturelle qu’ils avaient avant d’avoir ces outils pour les aider. Ils se sont habitués au confort et s’ils venaient à perdre se confort alors ils seraient très malheureux car ils n’ont plus l’habitude de vivre simplement. Plus grave encore, pour Rousseau, la vie en société pousse l’homme à vouloir toujours plus que son voisin, elle lui fait développer des désirs inutiles (avoir une demeure luxueuse etc) et le rend dépendant du regard des autres. Les hommes sont d’abord soucieux de l’image qu’ils renvoient et alors ils ne sont plus réellement eux-mêmes, ils vivent pour les autres, ils sont alors malheureux, envieux et méchants.
Citation :
« RAS. »
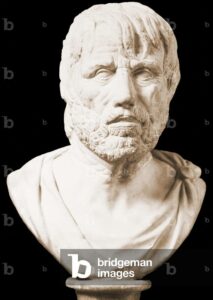
Philosophe stoïcien du 1ᵉʳ sicle ap. J.-C.
Peut-on se donner comme règle de suivre la nature ?
Oui, suivre la nature peut nous rendre heureux et libres
Thèse : Il faut vivre selon la nature pour être heureux.
Pour Sénèque, comme pour les stoïciens en général, pour vivre heureux et libre, il faut vivre conformément à la nature. Mais que faut-il entendre ici par nature ? Les stoïciens remarquent que la nature humaine consiste, d’une part, à vouloir son bien et, d’autre part, que les hommes sont doués de raison contrairement aux autres êtres. Vivre en suivant notre nature c’est donc vivre en suivant ce que nous dit de faire notre raison pour Sénèque. Cela suppose de ne pas céder à ses passions ou désirs pour suivre la raison. Par ailleurs, chez les stoïciens, la nature c’est également le monde ou l’ordre du monde. Pour eux comme pour Sénèque, pour être heureux, l’homme ne doit chercher à contrôler que ce pas qui dépend de lui c’est-à-dire ses pensées, sa volonté, sa raison et ne chercher à contrôler ce qui n’en dépend pas. Or, ce qui arrive, les événements du monde ne dépendent pas de nous. Vivre en suivant la nature c’est donc accepter ce qui arrive quand cela ne dépend pas de nous.
Citation :
« RAS. »
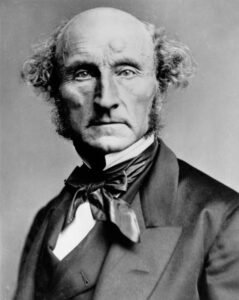
philosophe anglais du 19ᵉ siècle.
Peut-on se donner comme règle de suivre la nature ?
Non, car la nature ne fait pas toujours bien les choses
Thèse : Dire que pour vivre bien, il faut suivre la nature est absurde.
Dans La Nature, Mill montre qu’il est doublement absurde de prétendre qu’il faut suivre la nature pour vivre bien. D’abord, si l’on prend « nature » au sens des lois biologiques ou physiques de la nature, alors nous n’avons tout simplement pas le choix. Nous sommes soumis aux lois de la nature. Nous avons besoin de manger par exemple et cela n’est pas un choix de notre part. Ensuite, si l’on prend « nature » au sens de ce qui n’est pas créé ou transformé par l’homme, alors comment pourrait-on vouloir suivre la nature ? Cela signifierait ne pas nous vétir, ne pas faire d’agriculture. Cela signifierait également tuer pour survivre sans égards pour les autres.
Citation :
« La simple vérité est que la nature accomplit chaque jour presque tous les actes pour lesquels les hommes sont emprisonnés ou pendus lorsqu’ils les commettent envers leurs congénères. »
John Stuart Mill, La nature

Philosophe français du 17ᵉ siècle.
Les êtres humains sont-ils à part dans la nature ?
Oui, les hommes sont supérieurs par leurs facultés
Thèse : L’homme est le seul à avoir une âme et le libre arbitre.
Au 17e siècle, l’étude scientifique de la nature a recours à divers principes d’explication, parmi lesquels le principe mécaniste. Celui-ci assimile la nature à une grande machine, dont le fonctionnement dépend de l’agencement des parties, toutes dépendantes les unes des autres. Ce principe a été utilisé également pour l’étude du vivant : on pensait que les lois s’appliquant au monde physique s’appliquaient aussi au vivant et donc aux animaux. Les scientifiques de l’époque considèrent que le vivant est lui aussi un ensemble de tuyaux, de ressorts et de pistons. Cette conception peut-être illustrée par la théorie des animaux machines de Descartes. Les animaux étant, selon lui, des automates avec une pompe en guise de cœur et des ressorts pour les nerfs. La mort du vivant est alors identifiée à la panne d’un automate. Qu’en est-il de l’homme ? L’homme aussi est une machine, mais contrairement aux animaux, il a une âme qui conduit cette machine. Il n’est pas purement automatique, mais a le libre arbitre.
Citation :
« RAS. »
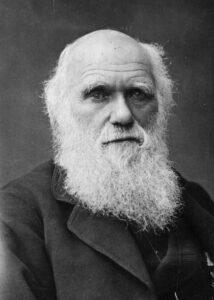
naturaliste anglais du 19ᵉ siècle.
Les êtres humains sont-ils à part dans la nature ?
Non, les hommes sont une espère comme une autre
Thèse : L’espère humaine est le résultat de l’évolution des espèces.
L’idée que l’homme a une place à part dans la nature a été fragilisée au 19ème siècle par Charles Darwin, qui a démontré que l’homme est une espèce animale parmi d’autres, apparentée biologiquement aux animaux, et qui nous n’est aucunement l’aboutissement ultime de l’évolution. Darwin montre, en effet, dans la théorie de l’évolution que l’être humain n’est pas une espèce à part qui aurait été crée par Dieu. Il défend au contraire que sommes parents des autres animaux et montre que notre espèce est le résultat de l’évolution comme toutes les autres espèces. Selon Darwin, les espèces évoluent par mutation puis sélection en fonction de l’adaptation au milieu. Des mutations génétiques ont lieu au hasard, certaines donnent un avantage à l’individu, il va alors plus facilement survivre dans son milieu et transmettre ses gènes. Dans le cas, contraire, il survivra difficilement et la mutation ne se transmet pas.
Citation :
« RAS. »
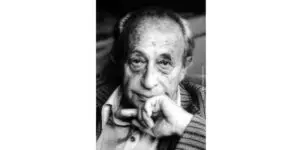
philosophe allemand du 20ᵉ siècle
Les êtres humains sont-ils à part dans la nature ?
Oui, les hommes sont à part, mais cela les rend plus responsables encore.
Thèse : Les hommes sont à part car ce sont de grands destructeurs. Cette force nous donne une responsabilité.
Hans Jonas fait un constat : pendant des millénaires, les hommes ont appris à dominer et contrôler la nature, afin de vivre dans davantage de sécurité et de confort. Mais, au XXe siècle, le développement technique de l’humanité est tel que les hommes finissent par être menacés par le développement technique lui-même. La technique n’est plus un moyen de protection, mais devient un danger à la fois pour la nature et pour les êtres humains. Selon lui, nous avons crée quelque chose qui nous échappe et pourtant, nous sommes, à ses yeux, responsables de la planète que nous allons laisser aux générations futures. Nous possédons aujourd’hui un énorme pouvoir de destruction sur la nature et sur l’humanité. Cette destruction pourrait être immédiate si l’on pense aux armes atomiques ou progressive si l’on pense plutôt à la pollution et au réchauftement climatique. Hans Jonas défend que nous avons des devoirs moraux envers les générations futurs et la nature. Il propose donc une nouvelle règle morale qui consiste en une reformulation de l’impératif catégorique de Kant (ci-dessous). Cet impératif doit alors nous conduire à adopter des modes de vie qui cessent de détruire la planète. Nous devons renoncer à certaines habitudes et à un certain confort pour préserver la planète et la qualité de vie des générations futures.
Citation :
« Agis de telle sorte que tes actions soient compatibles avec la permanence d’une vie humaine authentique sur la terre. »
Hans Jonas, Le principe de responsabilité